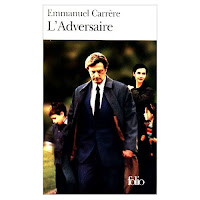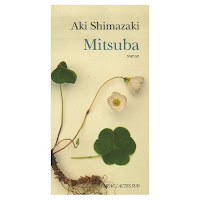"À l'abri de rien" Olivier Adam. Roman. Editions de l'Olivier, 2007 « Pas besoin de préciser. Nous sommes si nombreux à vivre là. Des millions. De toute façon ça n'a pas d'importance, tous ces endroits se ressemblent, ils en finissent par se confondre. D'un bout à l'autre du pays, éparpillés ils se rejoignent, tissent une toile, un réseau, une strate, un monde parallèle et ignoré. Millions de maisons identiques aux murs crépis de pâle, de beige, de rose, millions de volets peints s'écaillant, de portes de garage mal ajustées, de jardinets cachés derrière, balançoires barbecues pensées géraniums, millions de téléviseurs allumés dans des salons Conforama. Millions d'hommes et de femmes, invisibles et noyés, d'existences imperceptibles et fondues. La vie banale des lotissements modernes. A en faire oublier ce qui les entoure, ce qu'ils encerclent. Indifférents, confinés, retranchés, autonomes. Rien : des voitures rangées, des façades coll