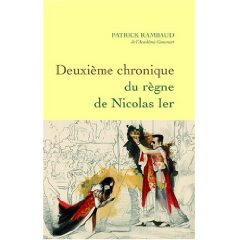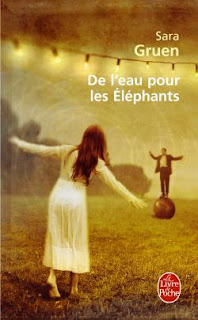"Mort aux cons" Carl Aderhold. Roman. Hachette Littératures, 2007. Qui n’a pas rêvé un jour de se débarrasser de certaines personnes de son entourage, généralement qualifiées de « cons » ou de « connes » ? L’espèce, il faut bien le dire, en est fort répandue et je ne connais à ce jour personne qui n’ ait été confronté à cette engeance et n’ait souhaité utiliser des moyens peu avouables pour s’en défaire. Heureusement, ces pulsions criminelles, qui nous poussent à imaginer toutes les morts possibles pour ces fâcheux, en restent, dans la majorité des cas, au stade du fantasme. Ils sont partout : au travail, dans notre voisinage, sur la route, en ville ou à la campagne, dans les gares, les aéroports, les grandes surfaces, et même au sein de votre propre famille…et si, rentrés chez vous, vous croyant à l’abri de leurs nuisances, vous avez la malheureuse idée de lire le journal ou d’allumer votre radio ou, pire encore, votre poste de télévision, attendez vo...