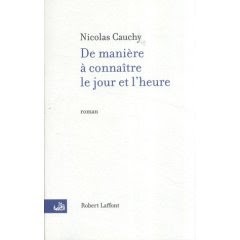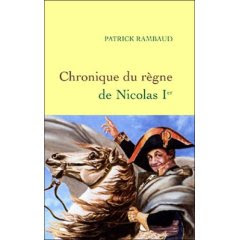"Le mec de la tombe d'à côté" Katarina Mazetti. Roman. Gaïa Editions, 2006 Traduit du suédois par Lena Grumbach et Catherine Marcus. Elle s'appelle Désirée. Elle est bibliothécaire. Régulièrement, elle se rend au cimetière pour se recueillir sur la tombe de son mari. Là, elle observe le type de la tombe d'à côté. Un drôle de type, d'ailleurs, un peu rustre, habillé de manière voyante, avec seulement trois doigts à la main gauche, et qui laisse dans son sillage traîner une drôle d'odeur. Lui, c'est Benny. En passe de devenir un « vieux garçon », il vient régulièrement sur la tombe de ses parents depuis qu'il vit seul dans la ferme familiale suite au décès de sa mère. Il ne sait que penser de celle qui vient sur la tombe d'à côté, cette femme terne aux cheveux si blonds qu'ils en paraissent presque blancs, cette femme mince et toujours vêtue de beige, affublée d'un bonnet hideux. Assurément, ces deux personnages-là n'ont rien en com...