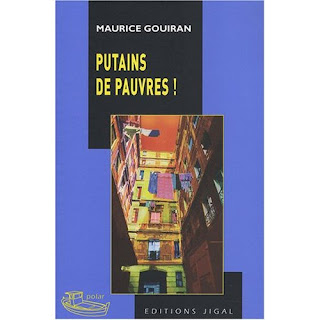Les Cendres

"La Route" Cormac Mc Carthy. Roman. Editions de l'Olivier, 2008. Traduit de l'anglais (Etats-unis) par François Hirsch. Depuis combien de temps marchent-ils sur cette route ? Devant eux ils poussent un vieux caddie rempli d'objets nécessaires à leur survie : nourriture, couvertures... Autour d'eux tout n'est plus que cendres. Le monde que nous connaissons n'est plus. Il a disparu dans ce qui apparemment ressemble à un conflit nucléaire. Tout est calciné, il n'y a plus ni végétation ni animaux. Les jours sont courts, sous un ciel gris et bas que ne perce pas la lumière du soleil. Le froid s'est installé en un hiver perpétuel. Alors l'homme et son fils marchent vers le Sud, vers la mer. Là, peut-être trouveront-ils un peu plus de chaleur, un peu plus de lumière, quelque chose aussi qui puisse ressembler à une ébauche de civilisation ? C'est leur voyage que nous décrit Cormac Mc Carthy dans ce très beau roman dépouillé à l'extrême. Pas...