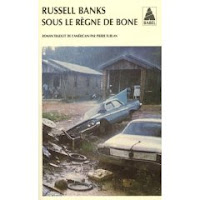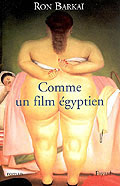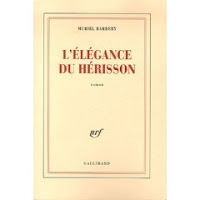Le 5e Prix des Lecteurs du Télégramme # 3

"Le coeur de l'hiver." Dominic Cooper. Roman. Editions Métailié, 2006. Traduit de l'écossais par Bernard Hoepffner. Il existe en littérature un thème romanesque, celui du vieil homme confronté à une nature hostile, qui a donné lieu à de nombreux chefs d'oeuvre dont les plus célèbres sont, entre autres, « Le vieil homme et la mer » d'Hemingway, « le vieux qui lisait des romans d'amour » de Luis Sepulveda ou encore « Le jour avant le lendemain » de jorn Riel. « Le coeur de l'hiver » de Dominic Cooper appartient lui aussi à ce genre littéraire et , à l'instar des exemples cités plus haut, est digne d'être classé en bonne place parmi ces excellents romans. Le personnage central du récit, Alasdair, est un homme des highlands qui, depuis la mort de son père et le départ de son frère, vit seul et exploite la petite ferme familiale située sur la côte occidentale de l'Ecosse. Sur ces rivages battus par les vents de l'Atlantique, la vie est ...