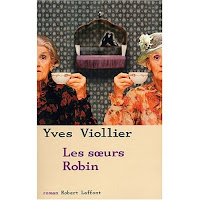Le Cycle du "Monstre" Enki Bilal. Bande-Dessinée. Casterman - Les Humanoïdes Associés, 1998, 2003, 2006, 2007. Ils sont tous trois orphelins, deux garçons et une fille, Nike, Amir et Leyla, nés en Aout 1993 lors du siège de Sarajevo. Ils ont partagé la même chambre d'hopital tandis qu'autour d'eux la tuerie faisait rage. Trente trois ans plus tard ( en 2026 ) ils vont tenter de se retrouver. C'est ainsi que commence la tétralogie du « Monstre » , le nouveau cycle de bandes-dessinées réalisé par Enki Bilal et qui ( à moins d'une surprise ) s'achève avec l'album « Quatre ? » Tétralogie? Rien n'est moins sûr au vu des derniers développements du récit. Bilal nous réserverait-il une pentalogie ? C'est fort possible. Mais pour le moment lui seul pourrait apporter une réponse à cette interrogation. Le cycle du « Monstre » nous emmène aux quatre coins du monde, dans un récit à trois voix, celles de Nike, Amir et Leyla. De New-York à Moscou, d...