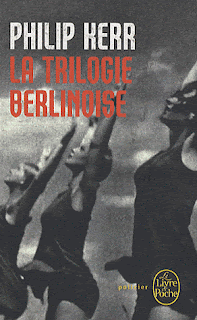L'Enfer Blanc

"Terreur" Dan Simmons. Roman. Robert Laffont, 2008. Traduit de l'américain par Jean-Daniel Brèque. Dans ces deux genres littéraires que sont le fantastique et la science-fiction, Dan Simmons appartient à la catégorie des poids lourds. C'est avec bonheur que je me souviens des heures passées à lire le cycle d' " Hypérion " ainsi que « L' É chiquier du Mal ». Puis l'engouement pour cet auteur s'était quelque peu refroidi pour moi suite à la lecture laborieuse et indigeste du dyptique « Illium-Olympos » qui m'avait laissé très dubitatif. Heureusement, c'est avec un grand plaisir que j'ai pu renouer avec cet auteur suite à la lecture de « Terreur ». Encore un pavé, certes, comme excelle à en produire Dan Simmons, mais quel pavé ! Voici en effet un ouvrage de plus de mille pages qui va nous entraîner dans une aventure dantesque retraçant la dramatique expédition polaire de Sir John Franklin , partie d'Angleterre le 19 m...