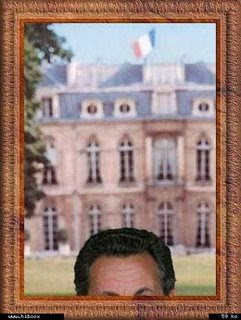Lafcadio et les fantômes
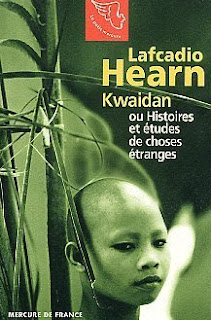
"KWAIDAN ou Histoires et études de choses étranges" Lafcadio Hearn. Nouvelles. Mercure de France, 1983. Traduit de l'anglais par Marc Logé. Lafcadio Hearn (1850 – 1904) reste encore – et incontestablement – le plus japonais des auteurs occidentaux. Fils d'un chirurgien de l'armée britannique et d'une grecque, il naît sur l'île de Leucade. Abandonné par son père, puis par sa mère, il est élevé à Dublin par sa tante. Il perd un oeil à l'âge de treize ans en jouant avec ses camarades. Rejeté par sa famille à l'âge de seize ans, il est livré à lui-même et se rensd à Londres puis à Paris. Il émigre ensuite aux Etats-Unis où il vit misérablement en faisant carrière dans le journalisme. Il épouse en 1877 une cuisinière métisse mais les mariages mixtes sont alors illégaux. Il est, suite à cela, renvoyé du journal New-Yorkais l' Enquirer et part s'installer à Cincinnati, puis à la Nouvelle-Orléans où il s'intéresse de près à la culture créole. ...