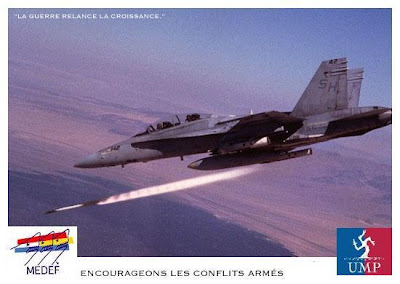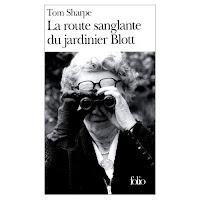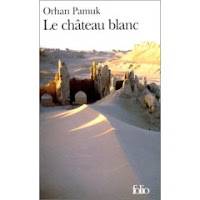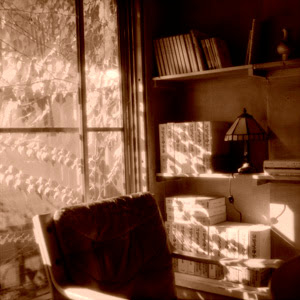Swimming with Sharks # 5 : "Ce n'est qu'un au revoir... "

"La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail" Laurence Parisot. Présidente du MEDEF. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui vendredi 31 aout l'université d'été du MEDEF vient de se clore. Nous sommes un peu tristes que ce soit déjà fini mais ainsi va la vie et le travail nous attend. Cette université d'été 2007 fut en tout cas un très très grand cru. Grâce à Laurence et Nicolas nous allons enfin pouvoir nous faire respecter de tous ces prolos qui nous empoisonnaient la vie depuis si longtemps. Bientôt c'en sera fini des 35 heures, et puis après ce sera le tour des syndicats, puis du code du travail, et puis, et puis... Bref, on a bien joué. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tous ces veaux ne disent rien. Il faut dire qu'à force de leur faire avaler de la merde tous les soirs à la télé, une huître aurait plus de chance qu'eux d'apprendre à chanter l'Internationale ! Enfin, soyons magnanimes. D'ailleurs, pour...