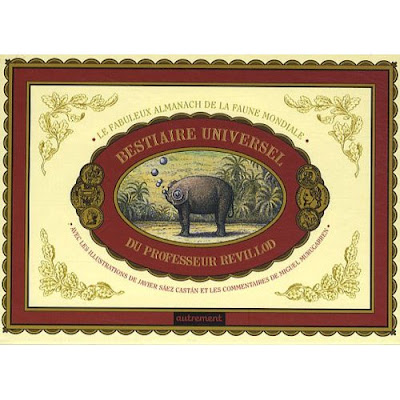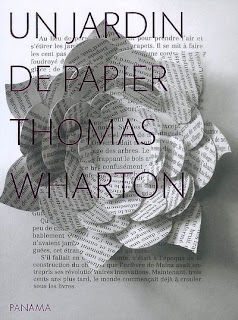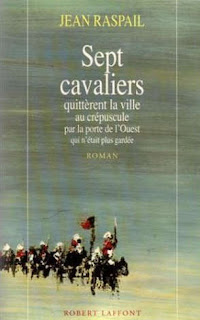"Le vampire de Ropraz" Jacques Chessex. Roman. Editions Grasset & Fasquelle, 2007. « Ropraz, dans le Haut-Jorat vaudois, 1903. C'est un pays de loups et d'abandon au début du vingtième siècle, mal desservi par les transports publics à deux heures de Lausanne, perché sur une haute côte au dessus de la route de Berne bordée d'opaques forêts de sapins. Habitations souvent disséminées dans des déserts cernés d'arbres sombres, villages étroits aux maisons basses. Les idées ne circulent pas, la tradition pèse, l'hygiène moderne est inconnue. Avarice, cruauté, superstition, on n'est pas loin de la frontière de Fribourg où foisonne la sorcellerie. On se pend beaucoup, dans les fermes du Haut-Jorat. À la grange. Aux poutres faîtières. On garde une arme chargée à l'écurie ou à la cave. Sous prétexte de chasse ou de braconne on choie poudre, chevrotine, gros pièges à dents de fer, lames affûtées à la meule à faux. La peur qui rôde. À la nuit on dit les pr