L' Histoire et la Pratique de la magie anglaise
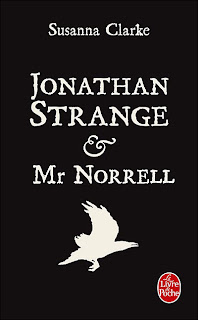
"Jonathan Strange & Mr. Norrell" Susanna Clarke. Roman. Robert Laffont, 2007. Traduit de l'anglais par Isabelle D. Philippe. Ayant vu ça-et-là nombre de critiques peu amènes à propos de ce roman, j’ai longuement hésité avant de me résoudre à me le procurer. Puis un jour j’ai sauté le pas et je dois dire que les vertes critiques que j’avais lues au sujet de ce pavé de 1140 pages me semblent aujourd’hui totalement infondées au regard de ce que j’ai pu découvrir en lisant cet épais roman. Oubliées, les remarques sur la longueur de ce récit prétendument interminable où il ne se passe rien sur des centaines de pages; oubliées également les attaques sur le style pesant et les dialogues infiniment longs qui prennent place sur l’action. N’en déplaise aux détracteurs de ce roman, nous ne sommes pas ici devant un ouvrage de la minceur de l’Amélie Nothomb annuel que l’on nous livre tous les ans à l’automne. Nous ne sommes pas non plus devant un de ces récits au rythme ...

