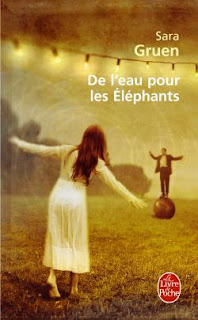Un manuscrit à oublier

"Codex le manuscrit oublié" Lev Grossman. Roman. Calmann-Lévy, 2007 Traduit de l'américain par Lisa Rosenbaum. Quand, dans les années 1980, Umberto Eco publia ses deux romans : « Le Nom de la Rose » et plus tard « Le Pendule de Foucault », il ne se doutait certainement pas – et nous, lecteurs encore moins – du formidable engouement qu'allaient susciter ses écrits. Ce succès légitime allait pourtant avoir une conséquence catastrophique dans le fait que nombre d'écrivaillons et d'éditeurs, tous fermement décidés à faire tinter leur tiroir-caisse, décidèrent de lui emboîter le pas en proposant aux lecteurs des romans à énigmes, mêlant intrigue policière et faits historiques plus ou moins sérieux, le tout saupoudré d'un zeste d'érudition destiné à faire croire aux lecteurs que le livre qu'ils ont entre les mains est plus qu'un simple roman destiné à les distraire, mais un ouvrage censé leur apprendre énormément de choses, voire leur révéle