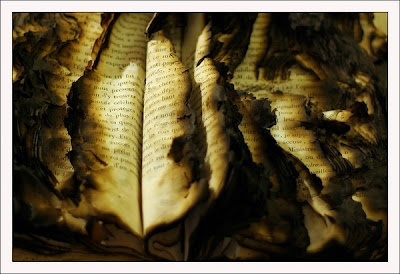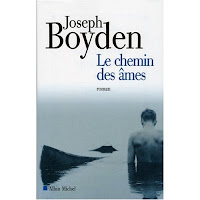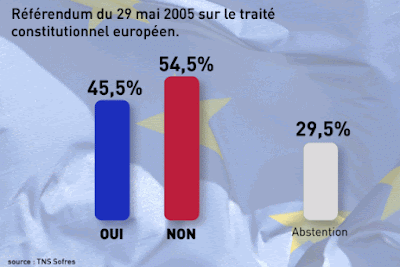Derrière le voile des apparences...

"Le poids des secrets" Aki Shimazaki . Roman. Leméac/Actes Sud "Le poids des secrets" Tsubaki , Leméac / Actes Sud, 1999 Hamaguri , Leméac / Actes Sud, 2000 Tsubame , Leméac / Actes Sud, 2001 Wasurenagusa , Leméac / Actes Sud, 2003 Hotaru , Leméac / Actes Sud, 2004 Yukiko, une vieille dame, rescapée du terrible drame de Nagasaki, vient de s'éteindre. Sa fille reçoit alors, par l'intermédiaire de l'avocat de sa mère, deux lettres. La première lui est adressée tandis que l'autre devra être remise à un personnage dont jusqu'ici elle ignorait l'existence. Ce qu'elle apprend dans la lettre qui lui est destinée la stupéfie : son grand-père ne serait pas mort à cause de l'explosion atomique lors du bombardement de Nagasaki le 9 aout 1945, mais il aurait été empoisonné et serait mort avant l'explosion. L'auteur de cet empoisonnement ne serait autre que Yukiko, sa propre fille. Pourquoi ? C'est ce que va découvrir la jeune femm...