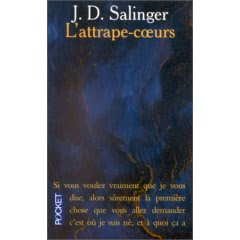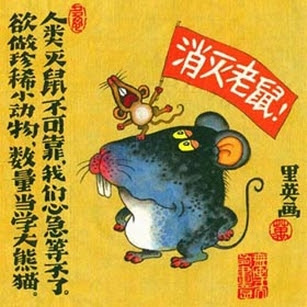Western

"Redemption Falls" Joseph O'Connor. Roman. Editions Phébus, 2007. Traduit de l'anglais (Irlande) par Carine Chichereau. Avec « Redemption Falls », Joseph O' Connor nous livre une page de l'histoire du peuple Irlandais, celle de ces émigrés qui, devenus américains, vont se déchirer et s'entretuer lors de la Guerre de Sécession qui fera se dresser les unes contre les autres les armées de l'Union contre celles des Etats Confédérés. Quand commence le roman de Joseph O' Connor, nous sommes en 1865 et la guerre vient de s'achever après la reddition du Général Lee à Appomatox (le 9 avril) et l'assassinat du président Abraham Lincoln par un sympathisant sudiste (le 14 avril). Mais ces personnages emblématiques de cette période troublée de l'histoire des Etats-Unis d'Amérique n'occupent que la toile de fond du roman de Joseph O' Connor. « Redemption Falls » s'ouvre en effet avec la longue marche d'une jeune fille, Eliza D...