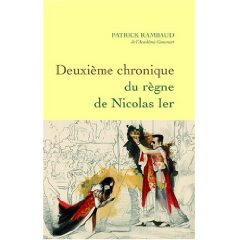Les fantômes de Venise

"La Taverne du doge Loredan" Alberto Ongaro. Roman. Anacharsis Editions, 2007. Traduit de l'italien par Jacqueline Malherbe-Galy et Jean-Luc Nardone. Schultz, ancien officier de marine devenu éditeur, occupe un antique palais vénitien hérité d’ancêtres autrichiens venus s’installer dans la Sérénissime en 1816 à l’époque de la domination des Habsbourg et de la création par l’empire autrichien du royaume de Lombardie-Vénétie. Il partage la jouissance de cette lugubre demeure avec Paso Doble, un étrange personnage, sorte de double de lui-même, un alter ego malicieux et imprévisible qui s’amuse à dissimuler quantité d’objets indispensables, obligeant ainsi Schultz à remuer ciel et terre pour retrouver son portefeuille, ses clefs ou encore les épreuves d’un ouvrage en cours de fabrication. Un troisième personnage -beaucoup moins remuant celui-là - habite dans la chambre d’amis. C’est une effigie de cire, assise dans un fauteuil, d’une superbe femme vêtue d’un long ...