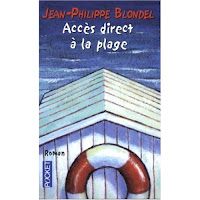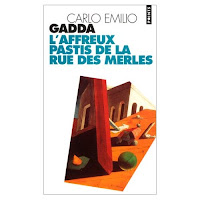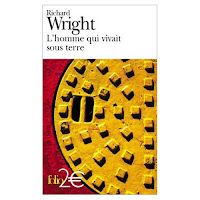Histoire du juif errant

"L'Homme aux yeux gris" Petru Dumitriu. Roman. Editions du Seuil, 1968, 1969 et 2005 C'est à Tolède, vers le milieu du XVIème siècle, que naît Archange. Fils d'un négociant en étoffes précieuses, il voit un jour ses parents condamnés au bûcher car étant de confession juive. Ayant échappé aux griffes de l'inquisition, le jeune garçon va être placé au service d'un peintre de renom : El Greco . Au cours d'une rixe, il va poignarder un homme, devra s'enfuir et vivre dans la mendicité en accomplissant de menus larcins. Il sera recueilli à Valence par un jeune prêtre qui fera de lui un enfant de choeur. C'est dans cette ville de Valence qu'il va rencontrer un maître d'armes à qui il va demander de lui apprendre à manier l'épée. Très doué pour l'escrime, il deviendra rapidement l'apprenti, puis l'aide de cet homme. Il va également faire la connaissance de deux jeunes nobles, Don Vincent et Don Séraphin avec qui il va nouer des ...