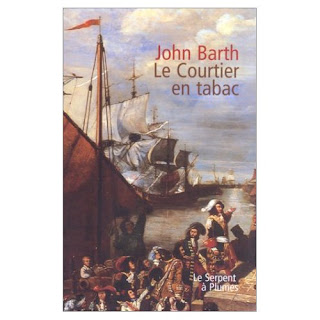L'année du tigre

Un jour de Nouvel An, Bouddha convoqua tous les animaux de la Création. Seuls douze d'entre eux se présentèrent. En remerciement, Bouddha leur offrit à chacun une année qui porterait leur nom et qu'ils influenceraient. Aujourd'hui débute l'année du Tigre. Si vous êtes né(e) en 1950, en 1962, en 1974, en 1986, en 1998, vous êts du signe du Tigre comme Emily Brontë, Marilyn Monroe, Rimbaud, Bayard, Robespierre, Schumann, Saint François-Xavier, Clovis... Le Tigre : prend des risques Frondeur et indiscipliné Tu es contre l'autorité Ton caractère est emporté Les autres tu aimes mener Tu cries "En avant" Avec quelle témérité ! Tous sont en admiration Taisant tes quatre vérités On te suit jusqu'au bout Comme derrière un chef Tigre un peu casse-cou Quelle vie passionnée ! Tu prends des risques Fais un peu attention T'es pas toujours un lion ! On dit que t'as la baraka Mais suis les conseils du Cheval Pour te calmer il sera là Du serpent ce n...