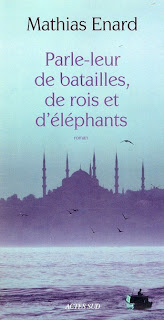Imposteurs !!!

"Bibliomanies" Collectif. Anthologie. Ivres de Livres, libraire-éditeur, 2011. « Ivres de Livres », libraire-éditeur à Strasbourg, nous offre, avec « Bibliomanies », une passionnante anthologie sur le thème de cette pathologie que l'on nomme bibliomanie ou encore bibliolâtrie . On y verra que cette curieuse maladie faisait déjà parler d'elle dès l'Antiquité et fut brocardée par des auteurs aussi illustres que Sénèque et Lucien de Samosate . Plus tard, au Moyen- Â ge, c'est le poète Pétrarque qui tourne en ridicule ces vaniteux bibliomanes qui pensent qu'accumuler chez eux un nombre incalculable de livres leur donnera une aura de sapience et de respectabilité : « Assurément, si l'abondance de livres faisait des savants ou des gens de bien, les plus riches seraient les plus savants de tous et les meilleurs, tandis que nous voyons souvent le contraire. » Mais c'est après l'invention de l'imprimerie et la propagation à g...