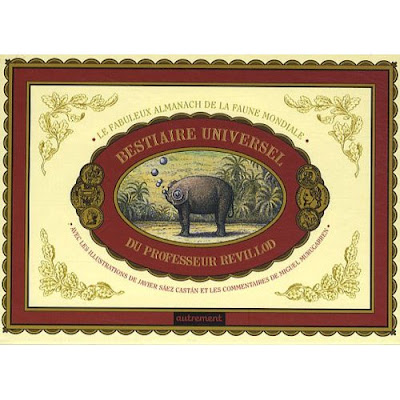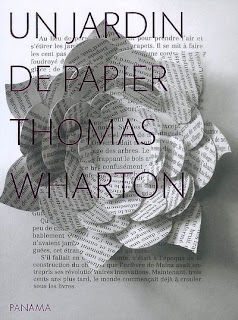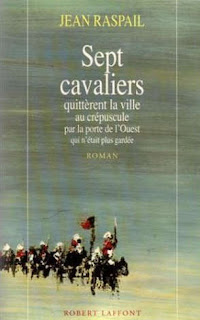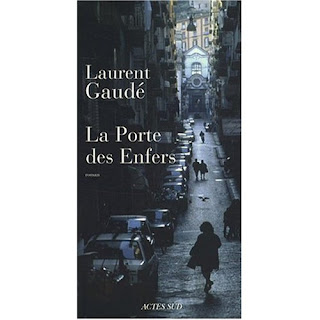"Une éducation libertine" Jean-Baptiste del Amo. Roman. Gallimard, 2008. « Paris, nombril crasseux et puant de France. Le soleil, suspendu au ciel comme un oeil de cyclope, jetait sur la ville une chaleur incorruptible, une sécheresse suffocante. Cette fièvre fondait sur Paris, cire épaisse, brûlante, transformait les taudis des soupentes en enfers, coulait dans l'étroitesse des ruelles, saturait de son suc chaque veine et chaque artère, asséchait les fontaines, stagnait dans l'air tremblotant des cours nauséabondes, la désertion des places. Dans cette géhenne, la chaleur de l'été collait aux visages comme un masque, drapait les corps de feu, tuait les bêtes qui tentaient de survivre en quelque coin d'ombre, suffoquait les femmes uax poitrines poisseuses. Les glandes sudorales déversaient par flots leurs humeurs. Jaillies d'aisselles velues, elles s'écoumaient des fesses aux flancs puis sur les jambes. Fondue comme du beurre sur les fronts, la sueur pi...