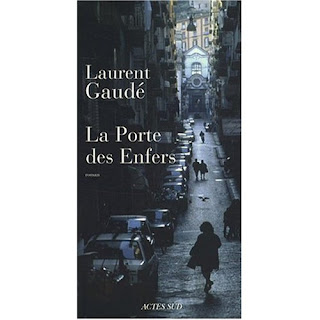"Deux frères"

"Les Thibault" Roger Martin du Gard. Roman. gallimard, 2003. « Deux frères », c'est le titre auquel avait pensé Roger Martin du Gard pour nommer ce cycle romanesque en huit épisodes avant de l'intituler « Les Thibault ». Cette vasque fresque, fruit de dix-sept ans d'écriture, qui nous mène des premières années du XXe siècle jusqu'à la fin de la première guerre mondiale, a valu à son auteur d'obtenir le Prix Nobel de Littérature en 1937. Le premier épisode de cette série : « Le cahier gris », nous introduit au sein de cette famille de la grande bourgeoisie parisienne, famille séverement régentée par le pater familias , Oscar Thibault qui, veuf, dirige seul et d'une main de fer sa maisonnée. Le vieil homme a fort à faire car le plus jeune de ses deux fils, Jacques, vient de fuguer en compagnie de son ami Daniel de Fontanin. La cause de cette fuite a été motivée par la découverte à l'école d'un cahier gris que s'échangeaient les deux élè...