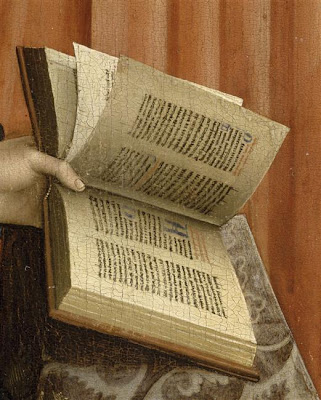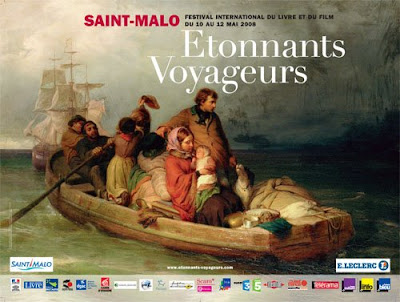Le violoncelliste

"Ce silence-là" Franck Bellucci. Roman. Editions Demeter, 2008 Qui est cet étrange jeune homme que la gendarmerie a récupéré, errant et hagard, sur une plage du littoral normand ? Vêtu d'un habit de gala, serrant contre sa poitrine une liasse de partitions musicales, l'inconnu semble muet et frappé d'amnésie. Aussitôt pris en charge par les autorités, le voici admis dans le service psychiatrique de l'hopital de L. Malgré toutes les tentatives des médecins et des enquêteurs, le mystère reste entier en ce qui concerne l'identité du patient de la chambre 22. Le jeune homme semble muré dans son silence et aucune stimulation sensorielle ne semble réussir à le sortir de son état apathique. Hélène, l'infirmière chargée de le surveiller, s'interroge elle aussi sur le mystère qui entoure ce jeune inconnu. Ses questionnements vont peu à peu céder la place à une étrange fascination envers celui qu'elle va finir par considérer comme « son patient ». La j...