Chasseurs de Nuages

"La Théorie des Nuages" Stéphane Audeguy. Roman. Gallimard, 2005 « Quand virginie Latour commence à travailler pour Akira Kumo, elle n'a bien évidemment, de toute sa vie, jamais pensé aux nuages. D'une façon plus générale, comme tout le monde, elle n'a presque jamais pensé ; ou alors juste un peu, en classe de terminale, le vendredi matin, dans le but exclusif de rédiger des dissertations de philosophie.Mais, contrairement à beaucoup de ses camarades, Virginie Latour a aimé penser, même au lycée ; elle a aimé cet exercice patient, laborieux, désertique et peuplé. Après les études tout s'est passé très vite, il y a eu les transports en commun, les courses et le ménage, le travail salarié. Ca a été fini parce que la pensée est un travail, parce qu'il faut des conditions spéciales pour penser : un peu de silence, un peu de temps, un peu de régularité, un peu de talent aussi. Il faut s'entraîner et certainement on pourrait, en théorie du moins, penser n...





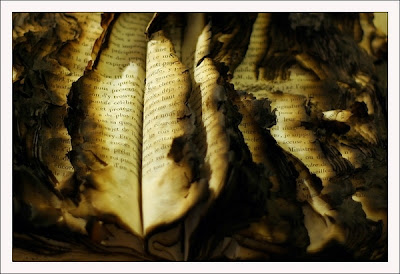















.jpg)


