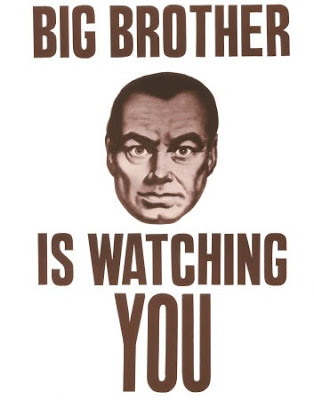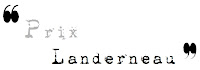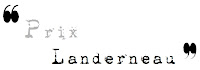Mektoub
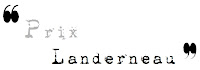
"La main de Dieu" Yasmine Char. Roman. Gallimard, 2008. C'est avec « La main de Dieu » que s'achève cette série de billets consacrés à la sélection des dix romans choisis pour le Prix Landerneau . C'est aussi avec ce commentaire que je dois déterminer celui qui, parmi ces dix ouvrages, est à mon avis, le lauréat. On le sait, cela a déjà été annoncé ici , le Prix Landerneau a été décerné par le jury à Yasmine Char pour « La main de Dieu » le 16 juin dernier, talonné de près par « Le théorème d'Almodóvar » d 'Antoni Casas Ros. Cependant, j'ai été sollicité parmi d'autres bloggueurs et bloggueuses pour déterminer quel serait mon choix si j'avais moi aussi fait partie de ce jury. Ainsi, chacun des bloggueurs sélectionnés à eu pour tâche de choisir qui, à son avis, était susceptible de remporter ce Prix. J'ai donc lu ces dix romans et après maintes tergiversations, débats, controverses et délibérations entre moi et moi, j'ai fait mo...