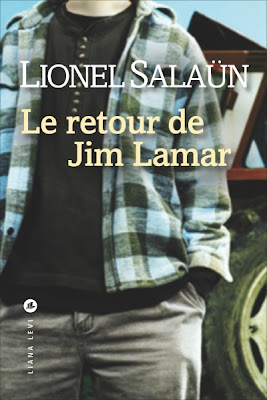Ce n'est qu'un au revoir...J'apprends

Vous l'avez remarqué, depuis pas mal de temps mes billets se font plus rares. Manque de temps, manque de volonté, je n'arrive plus à tenir le rythme et à commenter chaque livre que je lis. Les ouvrages en attente de commentaires s'empilent de plus en plus sur et autour de mon bureau, à tel point que je me demande s'il me sera un jour possible de combler ce retard. Je vais donc, pour un temps encore indéfini, mettre ce blog en pause et je ne sais pas combien de temps durera cette parenthèse. Merci à toutes et à tous, vous qui venez régulièrement ou par hasard sur ce petit espace consacré à mes lectures. A bientôt.