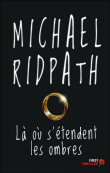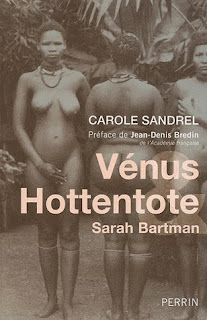"Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates" Mary Ann Shaffer & Annie Barrows. Roman. Editions Nil, 2009. Traduit de l'anglais par Aline Azoulay-Pacvon. Voici un cercle littéraire qui, depuis sa sortie en 2009, a fait couler beaucoup d’encre et de pixels. Porté aux nues par certains, décrié par d’autres, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ouvrage de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows n’est pas passé inaperçu et est rapidement devenu l’un des plus grands succès éditoriaux de ces dernières années. Bien sûr, la communauté des lecteurs n’est jamais unanime sur la qualité d’une œuvre et, face au déferlement d’avis positifs qui ont accompagné la sortie de ce roman, certaines voix se sont faites entendre, qui ne trouvaient pas cet ouvrage aussi extraordinaire que l’on voulait bien nous le faire croire. Ce fut le cas dans mon entourage où j’entendis des avis plutôt mitigés sur ce roman, voire quasiment négatifs. Inquiété par ces critiques, et infl