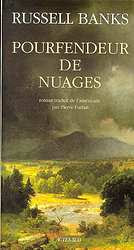"La Belle Etoile" Xavier Deutsch. Roman. Le Castor Astral, 2002. Sapin est officier en second sur la cargo français « La Belle Étoile », navire actuellement à l'ancre dans la rade de Lushun . En attendant les ordres de l'armateur qui donnera au capitaine du cargo le signal du départ, Sapin erre dans les rues de la ville portuaire chinoise, observant le spectacle du flot innombrable des réfugiés qui convergent vers la ville dans l'espoir d'échapper à la terrible menace qui, née dans le Nord de l'Asie, déferle sur le continent, provoquant une immense panique qui a jeté les populations sur les routes. Qu'est-il arrivé ? Est-ce une épidémie, une guerre, une catastrophe naturelle, qui a poussé des millions d'êtres humains à fuir dans un mouvement de panique indescriptible ? Non, ceux qui sont à l'origine de cet immense bouleversement, ce sont les dogues. « Ils avaient émergé en haut de l'Asie, en douze origines. Les uns, de l'Altaï, en ava